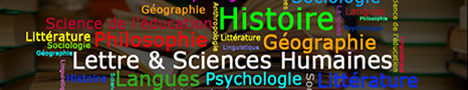Exposé de Pierre A. R. Kipré sur
Les lieux de création et de diffusion de la pensée africaine contemporaine
(Abidjan, le 13 décembre 2023)
Introduction
En 2017, dans une équipe d’historiens surtout venus d’Afrique et des diasporas africaines, l’UNESCO m’a fait l’honneur de m’associer à la révision de l’ancienne version de sa monumentale Histoire Générale de l’Afrique. Ce projet vise à tenir compte des fantastiques progrès enregistrés dans l’écriture de l’histoire de l’Afrique au cours de ces deux dernières décennies. A l’issue de longues discussions, le nouveau Comité scientifique a constaté que l'Afrique et ses diasporas ont été présentées jusque-là comme des groupes distincts, séparés par des océans, qui n’ont eu que des contacts sporadiques durant de brefs moments historiques. Pour cette version révisée, nous avons tous voulu rompre avec cette perspective réductrice en adoptant le concept d’Afrique globale.
Contre les critiques de certains Occidentaux[1], qui accusent les Africains de considérer leur continent comme une unité géographique d’appartenance unique et intemporelle, le concept permet une relecture innovante de ces liens. Il signifie que l’histoire de ces relations est un processus articulé et continu, fait de circulation de personnes, de connaissances, de savoir-faire, de productions culturelles. Sa matrice est l’héritage africain dans sa diversité. Il permet de dépasser la question de la race et met l’accent sur la présence multiforme de l’Afrique dans les différentes régions du monde comme sur la diversité de ses influences dans les autres cultures.
C’est donc sur cette base théorique que je m’en vais vous entretenir des lieux de création et de diffusion de la pensée africaine contemporaine.
Entre les réalités des espaces de sa production et l’absolue nécessité de répondre à l’accusation d’atonie de cette pensée, quelles sont les marges de manœuvre du « producteur d’idées » sur le continent et dans ses diasporas pour développer une pensée autonome et fécondante dans le monde aujourd’hui ?
- Un inventaire des lieux de production
Un inventaire des lieux de production de la pensée africaine fait ressortir trois caractéristiques principales : leur éparpillement malgré la domination de deux pôles majeurs sur le continent ; le profond déséquilibre de niveau et de disponibilité des ressources humaines ; les difficultés de coordination ou d’articulation des moyens de la production dans l’Afrique globale.
Le classement des universités et centres de recherches sur le continent met en lumière, en effet, deux grands pôles : l’Afrique australe, avec principalement l’Afrique du Sud, et l’Afrique du Nord, avec surtout l’Égypte. En 2016, ces pôles occupaient 76% des 100 premières universités africaines et 70% des principaux centres de recherches ; en 2022, 50% des 66 meilleures universités sont dans ces deux pôles. Bien qu’actives ces dernières années, l’Afrique orientale (surtout l’Éthiopie et le Kenya) et l’Afrique de l’Ouest (principalement le Nigeria) sont des pôles secondaires.
Le nombre des publications en sciences sociales, le volume de la production littéraire et artistique comme celui des publications scientifiques font apparaître quatre pôles principaux : l’Afrique du Sud (47% des productions), le Nigeria (15,6 %), l’Égypte (6,8 %) et le Kenya (6,5 %).
Ces deux indicateurs sont en rapport avec le niveau d’accès à la formation et à l’enseignement supérieur autant qu’ils sont en lien avec les capacités d’encadrement des institutions. D’un Etat à l’autre, les différences sont souvent prononcées en Afrique.
Dans les diasporas africaines, on tire parti des opportunités multiculturelles qu’elles vivent au quotidien grâce à l’existence de très vieilles institutions de création et de diffusion de la pensée.
La diaspora d’origine lointaine, c-à-d, celle des descendants des victimes de la traite négrière, inscrit l’essentiel de ses productions dans le cadre de la transformation de sociétés qu’elle a contribuées à construire. La diaspora issue des migrations coloniales et postcoloniales des XXe et XXIe siècles restitue ses combats pour la survie à l’étranger, mais aussi pour la transformation de l’Afrique globale. Ces producteurs d’idées sont tous des « passeurs » entre le reste du monde et notre continent depuis le début du XXe siècle[2]. Le pôle géographique dominant est ici celui surtout de l’Amérique du Nord, secondairement celui des Caraïbes, du Brésil et de l’Europe occidentale ; les pôles asiatiques sont marginaux.
- Les contenus principaux et les tendances de la pensée africaine contemporaine :
Lorsque nous parlons de science, il s’agit de l'étude de la structure et du comportement du monde physique par l'observation, la mesure et l'expérimentation. Selon les méthodes de chaque activité scientifique ou littéraire, il s’agit aussi du développement de théories pour décrire les résultats de ces activités. Les sciences nous permettent ainsi de concevoir tous les outils nécessaires pour répondre aux besoins humains et sont des moyens puissants d'anticipation des crises autant que de planification des développements futurs.
En 1947, dans le numéro de lancement de sa revue Présence Africaine, Alioune Diop écrivait ces mots : « Le Noir qui brille par son absence dans l’élaboration de la cité moderne pourra, peu à peu, signifier sa présence en contribuant à la recréation d’un humanisme à la vraie mesure de l’homme ». Ce rêve fut long à devenir réalité. Il est encore vrai que nos lieux de production de la pensée contemporaine sont tous encore confrontées aux problèmes de la pérennisation interne et externe des productions[3].
Pourtant, il faut constater la forte présence actuelle des productions de l’africanité globale, depuis surtout le dernier tiers du XXe siècle. On a ainsi l’accélération des productions en sciences sociales et humaines depuis qu’est remise en cause la nature de l’Etat hérité de la fin des colonisations européennes ; on a aussi une abondante production littéraire et artistique de même qu’une actualité scientifique et technologique non-négligeable.
Deux thématiques principales peuvent être retenues ici. On a, d’une part, la volonté d’autonomie par l’expression et la défense de la liberté de dire l’Afrique ; d’autre part, la volonté ou le désir de participer activement à l’humaine aventure intellectuelle en cette période d’accélération/changement des paradigmes ; et la question de l’environnement n’est pas le moindre des domaines interrogés.
En effet, la maturation de la volonté d’autonomie s’est faite autant sur le continent lui-même qu’en dehors, au tournant de la fin du XXe siècle. L’apport de la diaspora récente a été décisif. Celui de la plus ancienne diaspora, celle des Afro-descendants des Amériques, l’est plus dans le développement de l’afrocentrisme de la fin du XXe siècle.
L’épuisement des anciennes thématiques du premier panafricanisme et les désillusions de la construction de l’Etat comme de la société postcoloniale ont expliqué la vague occidentale de l’afro-pessimisme. Mais, cela a aussi permis de voir peu à peu, d’abord chez les spécialistes africains des sciences sociales, que le point d’achoppement du développement de l’africanité globale était principalement le recours permanent à ce que Valentin-Yves Mudimbé (1988) a appelé « la bibliothèque coloniale »[4]. Celle-ci est une tentative de formatage permanent des esprits africains dans le moule de la pensée occidentale et européo-centrée ; car, pour elle, l’Afrique sans culture ni civilisation remarquable, en marge du monde parce que ne représentant que 2 % des échanges mondiaux, doit « s’occidentaliser » pour être vue au-dehors. Pour la génération d’intellectuels africains des années 70-80 (V-Y. Mudimbe, J. Ki Zerbo, Memel-Fôté, Cl. Aké, Samir Amin, Mahdi Elmandjara, etc.), le but de la réflexion africaine est donc la formulation d’un nouveau discours africain sur le monde, une pensée qui soit libérée des pesanteurs coloniales et précoloniales. C’est à partir de ce travail que peuvent émerger de nouvelles perceptions de nos peuples et de nos cultures.
Parfois influencés par les « subaltern studies» initiées par des intellectuels de l’Inde autour d’Edward Saïd, de nouvelles générations de penseurs africains se sont mises à réfuter définitivement les thèses forgées par les sciences sociales occidentales et l’arrogance épistémologique du milieu des experts occidentaux. Avec cette génération, l’avenir de l’Afrique ne se conçoit plus en lien avec celui d’une « Europe déclassée » (A. Mbembé).
Même s’il manque encore à l’Afrique des institutions capables d’inspirer totale confiance aux citoyens, aux consommateurs et aux investisseurs tout en permettant d’échapper à la « malédiction des ressources naturelles », c’est dans le prolongement de cette vague que sont apparus, ces dernières années, la demande de restitution des biens culturels pillés par les colonisateurs de l’Afrique ; c’est également dans ces milieux que se sont multipliés les débats sur les réparations qu’imposent la traite négrière atlantique et les exactions de la colonisation. Les pensées rebelles africaines se sont ainsi répandues partout dans l’Afrique globale, surtout à partir des années 90.
Dans les sciences humaines et de la société, on a une riche et abondante production dont l’objet est la réflexion à court, moyen et long terme sur les transformations sociales, politiques et économiques, leurs enjeux et leur articulation avec les problématiques de développement et/ou d’inclusion. Ces travaux sont disponibles dans les universités et centres de recherche, très souvent sous la forme de thèses et mémoires.
Dans les littératures, c’est le refus de l’exotisme. En effet, les ruptures sont spectaculaires dans le monde des littératures africaines. C’est une littérature très diversifiée ; ce qui ne lui enlève ni cohérence, ni rencontres, ni similarités de trajectoires ou au moins de situations dans l’histoire de la pensée humaine. L’écrivain d’Afrique, émigré ou non, continue d’être « la bouche des malheurs qui n’ont point de bouche ». On le voit avec A. Kourouma, T. Monenembo, Ken Bugul, C. Beyala, Driss Chraïbi, Tanella Boni, V. Tadjo, Kossi Efoui, etc. Mais, à la différence des générations précédentes, beaucoup entendent explicitement se dégager de la thématique identitaire. Ils aspirent à être reconnus selon leurs qualités propres, selon des schémas esthétiques propres à leur art. On a ici, parfois, une volonté d’identité plus individuelle et plus portée vers le reste de l’humanité que vers une « africanité » difficile à définir en raison des bouleversements en cours dans les sociétés africaines.
Dans les arts, c’est le rejet du « primitivisme » d’antan. Longtemps marginalisée, la création artistique africaine s’adapte aujourd’hui aux pulsions de la modernité, et, comme le dit le philosophe ivoirien Yacouba Konaté, « l'art dit contemporain africain souvent interroge, dans l'expression plastique, ses propres présupposés identitaires, avec ses nouvelles formes d'écriture, de matériaux qui débordent les disciplines plastiques classiques. L’offre artistique est immense et riche.»
Du continent ou de la diaspora, les artistes de l’Afrique globale veulent aujourd’hui situer leur art principalement en fonction de projets esthétiques capables de témoigner efficacement sur la part d’utopie et des possibles incrustés dans la création artistique spécifiquement africaine. Les ruptures avec les tendances littéraires et artistiques d’avant les années 90 visent, somme toute, à engager le continent dans la voie de l’affirmation d’une autre modernité.
Dans les sciences expérimentales, même dans les sciences de l’ingenierie, c’est la multiplication des travaux sur les spécificités des espaces physiques et de l’environnement africains en même temps qu’est exprimée la volonté de contribuer, même en mathématique, au progrès scientifique et technique universel. Voyez tous ces logiciels et les inventions des chercheurs africains en matière de produits pharmaceutiques ou autres réalisations technologiques, bien souvent pour les besoins propres des usagers Africains.
Grâce ce formidable travail de production intellectuelle, l’africanité globale permet de constituer de nouveaux savoirs, surtout pour et sur le continent. L’explosion de cette pensée nouvelle se caractérise par de nombreuses avancées théoriques en même temps qu’elle constitue des ruptures. Car, il s’agit de recentrer la question de la modernité.
Le problème de l’Afrique aujourd’hui est ainsi moins celui de l'identité ou de l'origine que celui de penser la façon dont les choses adviennent et comment on les transforme positivement par soi-même et pour soi. Cette question suscite de nombreux débats entre Africains ; et comme le disait A. Hampaté Bah, « la beauté d’un tapis provient de la diversité de ses couleurs ».
- Les modalités et obstacles de la diffusion :
Ces contenus sont diffusés d’abord par le livre. Celui-ci est un support de la pensée répandu de manière très large par les colonisations européennes des XIXe-XXe siècles. Même si les situations sont variées sur le continent, le savoir à travers le livre est devenu pour l’Afrique une donnée en soi, révélant une culture et se présentant comme outil de formulation de la modernité. C’est une grande rupture avec la culture de l’oralité qui avait été dominante dans les civilisations africaines d’avant le XXe siècle. Il faut toutefois avoir à l’esprit que le continent est encore celui qui pèse le moins en la matière dans le monde : avec 1,4 % de la production éditoriale mondiale pour 14 % de la population mondiale, le secteur du livre peine à prendre un véritable essor dans l’africanité globale.
L’une des raisons principales de cet état de choses est le faible niveau d’expression de la pensée africaine dans nos langues, sans l’intermédiaire des langues des anciens colonisateurs. C’est toute la problématique des travaux de nos linguistes aujourd’hui.
En effet, engagés dans le combat de la maîtrise, de la diffusion, de la promotion de nos langues et de leur utilisation comme langues de travail, les linguistes africains montrent que ces langues sont porteuses de culture et de civilisation ; elles sont ainsi une condition sine qua non pour comprendre et dire l’Afrique. Car, sauf le cas de langues africaines dans lesquelles des auteurs contemporains ont voulu écrire, la plupart de nos langues traduisent essentiellement les réalités socioculturelles des communautés qui les parlent. Dans le processus de contrôle de la société universelle du savoir, elles ne peuvent pas rivaliser avec les langues écrites sans adaptation et réajustement aux techniques d’aujourd’hui (informatisation, numérisation et présence dans les N.T.I.C.).
La question est donc moins celle des traductions (de la langue africaine aux langues européennes et vice-versa) que celle des moyens par lesquels les langues africaines doivent directement participer au respect de la diversité culturelle. C’est le sens même du basculement nécessaire de l’oralité de ces langues vers l’écriture. Largement décrites scientifiquement par nos linguistes, elles peuvent et doivent être écrites pour dire l’Afrique, de l’intérieur même de nos cultures. La langue n’est pas simplement un support de pensée ; elle est inséparable de la culture. On touche ici à un des facteurs importants du progrès, à savoir « la culture de l’accumulation » que permet le recours au savoir du livre.
Les contenus de la pensée africaine contemporaine sont aussi diffusés par les NTIC, notamment internet. Bien en vogue dans la jeunesse africaine aujourd’hui, cet outil connaît sa véritable révolution dans les années 2005-2010, lorsque le continent s’est connecté au reste du monde par les câbles sous-marins en fibre optique. L’évolution des taux d’acquisition d’ordinateurs et de logiciels ainsi que celle des taux de pénétration d’internet y sont aujourd’hui plus élevés que dans d’autres parties du monde, le nombre d’utilisateurs augmentant sept fois plus vite qu’ailleurs. Nos universités et centres de recherche tentent de n’être pas les derniers dans un domaine qui leur permet d’effectuer des bonds qualitatifs, tant dans la diffusion des savoirs que dans leur production.
Enfin, la pensée africaine est diffusée par les espaces de débats publics de la société civile[5]. Lointain héritage de « l’arbre à palabres » de nos cultures orales, ces espaces de débats sont surtout le produit des sociabilités urbaines contemporaines. Les idées y sont rarement nouvelles ; mais, lieux de joutes oratoires improvisées, c’est un indicateur du succès de courants de pensée politique ou économique et sociale en vogue, courants pertinents ou non, novateurs ou non.
Par ces trois medias, l’Afrique est entrée dans la construction de la société globale du savoir.
Mais, il y a ici de très nombreux défis à relever. Ces défis sont multiformes. Ils portent notamment sur les rapports des « producteurs » de pensée africaine avec leur public naturel. Rares sont aussi les États africains qui lient cette production d’idées contemporaines et la recherche d’un modèle de société future, en conformité avec les aspirations de la société en construction (ou en reconstruction). La nouvelle pensée africaine circule donc mal, surtout sur le continent. De cette situation découle un positionnement encore insatisfaisant dans le monde.
- Le positionnement de la pensée africaine d’aujourd’hui
Aujourd’hui, pour un positionnement satisfaisant de sa pensée, l’africanité globale doit résoudre quatre problèmes principaux :
Le premier est celui de l’articulation et de la coordination des lieux de production. Plusieurs organismes en Afrique tentent de mutualiser les savoirs, les acquis, les expériences, les projets et les perceptions (académies ou sociétés savantes nationales, régionales, continentales, etc.) Grâce à ces tentatives, qui souvent visent à constituer des réseaux régionaux et continentaux depuis environ deux décennies, le reste du monde découvre le dynamisme et la modernité de la contribution africaine contemporaine.
Mais, marquée par des méfiances réciproques, se pose une problématique importante, celle des rapports entre le monde des chercheurs ou des artistes et celui des acteurs politiques ou économiques. Elle est à la fois paradoxale et préoccupante.
Elle est paradoxale parce que les Etats, principaux financiers des universités, centres de recherches et des grands forums artistiques, sollicitent peu leurs lieux de production de la pensée nouvelle. Il existe encore un écart considérable entre les connaissances scientifiques produites et disponibles et leur utilisation dans le processus décisionnel des Etats, lors de la formulation, de l’exécution et de l’évaluation des politiques publiques. Les lieux de production et les producteurs finissent ainsi par être des « ghettos scientifiques et artistiques » dont les productions ont un faible impact sur le progrès des sociétés africaines elles-mêmes.
Elle est préoccupante parce que, au cœur du développement des sociétés humaines, la science offre une vision globale des progrès et en même temps des risques que courent les communautés humaines, surtout quand les progrès scientifiques vont de pair avec des progrès technologiques. Or, en Afrique surtout, tout se passe au niveau des décideurs politiques et économiques comme s’il y avait un hiatus entre l’analyse de ce qui est, les conséquences technologiques et le futur des communautés étudiées. Depuis les travaux pionniers du futurologue marocain Mahdi Elmandjara à la fin des années 80, toutes les études prospectives menées sur l’Afrique et par des Africains prouvent le contraire.
Cette situation vient de ce que les Etats africains semblent compter plus sur les résultats et questionnements venus d’ailleurs que de ceux de leurs propres lieux de production scientifique. Déjà, dans son livre sur La valeur des valeurs (2008), M. Elmandjara disait « Je crois que le sous-développement peut se définir aujourd’hui comme une situation où l’on combat les compétences nationales innovatrices et créatrices et où l’on encourage la somnolence professionnelle et la médiocrité docile ».
Ces dernières années, certains gouvernements africains ressentent l’obligation de se doter d’instruments scientifiques qui leur apportent les éléments destinés à fonder scientifiquement les politiques publiques. En ce sens, il faut rappeler la recommandation faite en 2019 par la Commission de l’U.E.M.O.A. d’avoir dans les Etats-membres des organismes d’aide scientifique à la détermination des politiques. L’idée donc se répand et traduit clairement une prise de conscience des décideurs politiques.
S’il faut saluer cette prise de conscience, qui renvoie à la nécessité de tirer le maximum de nos potentialités internes, la question reste timidement traitée parce que le format de ce type d’organismes est souvent mal assuré : les chercheurs, acteurs permanents de la production scientifique, sont peu associés à l’activité de ces organismes qui, le plus souvent, sont des démembrements spécialisés de l’administration qui n’intègrent pas une dimension essentielle de la démarche scientifique, à savoir la distance critique vis-à-vis de l’objet scientifique. Pire, la plupart capitalisent peu la recherche-action lors de la mise en œuvre des activités identifiées et dans l’élaboration des stratégies. La dissémination des résultats de la recherche est absente des politiques publiques et reste ainsi éloignée des préoccupations de ceux qui devraient être le public naturel de la recherche, à savoir les décideurs politiques et économiques, la société globale.
Les politiques publiques en Afrique doivent donc cesser d’être trop souvent approximatives. Elles doivent mieux organiser les relations entre les lieux de production de la pensée et les pouvoirs politiques autant qu’économiques pour faire avancer nos sociétés par elles-mêmes. C’est tout le sens du programme E-Policy que vient de lancer le BREDA/UNESCO.
Le troisième point d’interrogation est celui de l’absence de relations organiques entre l'Afrique et ses diasporas dans ce processus de production. Les liens avec l’Afrique sont encore largement informels. Bien que désignée « sixième région de l’Afrique » par l’Union Africaine, la diaspora n’est pas institutionnellement mise à contribution dans la production africaine d’idées novatrices. L’engagement et les réseaux personnels sont encore largement le principal mode de mobilisation d’un gisement exceptionnel de compétences que recèlent toutes ces diasporas. Car, ce gisement est de plus en plus nourri par la fuite des cerveaux, mode visible d’affaiblissement de la capacité de renouvellement des ressources humaines africaines.
Les chercheurs « juniors » sont de plus en plus nombreux, en comparaison des situations des années 80 et 90. Mais rien (ou presque) ne leur est proposé de façon pérenne pour les faire évoluer, les retenir en les intégrant mieux dans les communautés scientifiques, nationales ou interafricaines. Pour les « seniors », les raisons de l’évasion sont nombreuses ; ce sont de meilleurs avantages offerts à l’étranger pour l’accomplissement d’une carrière professionnelle démarrée dans son pays ou, bien souvent, des raisons plus politiques (l’exil forcé d’universitaires et intellectuels vers des pays plus stables).
Il faut toutefois dire que cette « fuite des cerveaux » n’a pas que des désavantages. Elle offre à l’Afrique de disséminer ses talents et d’établir des ponts avec d’autres espaces de production de la pensée, d’autres environnements scientifiques, pour peu que les États transforment en avantage ce qui est, au départ, une perte.
Le quatrième problème est celui de la reconnaissance de l’universalité de cette pensée africaine. La rencontre, même fortuite, avec les autres est le principal axe de la reconnaissance de l’africanité actuelle. Réelle aujourd’hui, elle l’est plus hors d’Afrique que sur le continent. En effet, pour les universitaires et écrivains africains, elle se manifeste à travers les invitations à des rencontres internationales, des publications dans des revues de renom, des missions d’enseignement dans des universités occidentales ou la participation à des projets de recherches proposés et coordonnés par les Occidentaux sur leurs propres thématiques. Plus « médiatisés », mais situant la place des Africains et leur diaspora dans le monde de la pensée universelle, c’est l’octroi de récompenses prestigieuses et de grands prix (prix Nobel, prix Noma, etc.) à des Africains.
Mais généralement, tout part de l’Occident, notre continent valorisant et promouvant peu ses propres producteurs ; ceux-là vivent dans un « ghetto intellectuel ». L’universalité de la pensée africaine n’est plus pourtant un mythe ; elle se mesure, au plan spatial, par la présence de l’africanité sur tous les continents, et il y a comme un ensemencement conscient ou inconscient des influences africaines contemporaines à travers les littératures, les arts, la participation aux débats d’idées et au progrès dans toutes les sciences.
Là où le bât blesse, c’est le très faible ancrage de la production et de la diffusion de la nouvelle pensée africaine dans l’espace social ; il est ici encore très insuffisant et reste le fait d’une faible proportion de l’africanité globale.
Conclusion
Il faut ainsi comprendre que nous sommes encore sur les marges de la société mondialisée du savoir, mais sans être en marge de l’enrichissement permanent de la pensée universelle. Le chemin pour être un des moteurs évidents de l’aventure intellectuelle universelle est long. Mais nous l’avons pris et c’est heureux.
Si nous convainquons notre jeunesse de travailler ici plus qu’ailleurs, si nous nous mettons à l’écoute de leurs véritables attentes, si nous mettons la production d’idées novatrices au centre de notre lutte pour le progrès et notre formulation propre de la modernité, si nous libérons le vaste gisement de pensées et de connaissances que cachent nos langues non encore écrites, nos marges de manœuvre et nos possibilités seront très grandes pour peser demain sur le cours de l’histoire de la pensée humaine,.
Pour tout cela, les politiques publiques doivent être en mesure d’assumer la volonté commune de transformation positive de nos sociétés, sans chausser les bottes des autres pour n’en être que la simple caisse de résonnance. Comme nous le disait feu Joseph Ki Zerbo en 1989, « On ne dort pas sur la natte des autres ».
[1] Le terme “Sud global” est un nouvel usage occidental, à la place de celui de “Tiers-Monde”, pour désigner les pays en développement qui dépendent du Nord global riche et à la pointe de la technologie, mais qui détiennent la majeure partie de la diversité génétique mondiale, des espèces uniques et des écosystèmes ; la notion regroupe les Etats du sud, principales victimes des effets néfastes de la mondialisation et refusant de s’aligner sur l’un ou l’autre des puissants du Nord global, cet autre nom de l’Occident.
[2] Par exemple, lancé par le poète Normil Sylvain au début du XXe siècle, le recours à l’Afrique l’emporte dans les littératures caraïbéennes ; J. Price-Mars (Ainsi parlait l’oncle en 1928) en est le meilleur chantre : « Nous n’avons des chances d’être nous-mêmes que si nous ne répudions aucune part de notre héritage ancestral. Cet héritage est pour les 8/10e un don de l’Afrique », écrivait-il.
[3] Par exemple, on constate que les politiques publics de recherche en Afrique se caractérisent par exemple par la médiocrité des financements. En Occident, on a 10% du PIB consacrés à la recherche et les USA plus la Chine représentent 63% de la croissance de la recherche (2014-2018), en Afrique, on a d’abord, l’exception sud-africaine dans laquelle l’Etat consacre autour de 0,7 % de son PIB à la recherche ; ensuite, une vingtaine de pays qui consacrent entre 0,4 % et 02 % du PIB ; enfin, une trentaine d’États qui se situent à moins de 0,2 %.
[4] En 1986, Tierno MONENEMBO, dans Les écailles du ciel, condamnait une certaine « toxicité » des théories politiques et économiques empruntées ou imposées de l’extérieur et que « les écailles » dans les yeux des élites intellectuelles (culture d’emprunt) gênaient le développement endogène.
[5] Ils ont fleuri ces dernières années sous diverses appellations dans les grandes villes ("grins" de Bamako, "agoras" d’Abidjan, "ebimeeza" de Kampala, "fada" de Niamey, etc.)